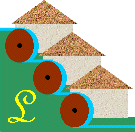

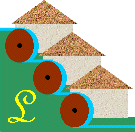
|

|
George de Monfreid n'était pas qu'un artiste peintre, il lui arrivait d'écrire pour des journaux :
- Vers 1880, il est correspondant pour le journal “ Le Yacht ”.
- Entre 1905 et 1913, il écrit des articles pour le journal “ La Montagne ”, organe du parti Républicain de l'arrondissement de Prades (Pyrénées-Orientales). Comme ses amis le Dr Arrous, Paul Paris, Gustave Violet..., il publie sous un pseudonyme : il est “ Montaigne neveu ” et publie une chronique irrégulière “ Lettres d'un parisien ”.
Pour illustrer cet aspect méconnu, j'ai choisi un article publié suite aux inondations de 1910 à Paris. Vous verrez son avis est partagé entre compassion et réserve...
La Montagne N°278 27 février 1910 (© Archives municipales de Perpignan)
De province je reçois une quantité de lettres me demandant si je nage en pleine inondation, si j'en suis réduit à camper dans une mairie ; on m'offre un refuge, un domicile, chez maint ami du Roussillon m'exhortant à fuir le fléau envahisseur... Que voulez-vous ? les grands quotidiens racontent, avec rubriques en manchette, que « Paris est sous les eaux ». On les croit textuellement !
Vous me demandez mes impressions de parisien sur ce désastre ? Car c'en est un, à coup sûr, immense et lamentable. Et l'on n'en pourra juger l'étendue que lorsque les eaux seront entièrement retirées. Mais aussi que d'imprévoyances ! - Ces ingénieurs qui construisent en sous-sol au bord de la Seine ! j'en ai fait la réflexion, et bien d'autres que moi aussi, quand j'ai vu construire la gare d'Orléans du quai d'Orsay. Je veux bien que cette crue ait été phénoménale, inusitée ; c'est entendu ! Mais les dégâts étaient déjà immenses, bien avant qu'elle eût atteint son maximum.
La difficulté des communications m'a empêché de voir la banlieue, Ivry, Alfortville. Je me rends compte que ça doit être navrant déjà. Car je le répète, la tristesse de cette calamité n'apparaîtra vraiment que lorsque ce sera fini. Pendant la crue, à dire vrai, ce que j'ai vu de Paris n'avait pas l'aspect sinistre qu'on a tant raconté. La misère des familles délogées, les dégâts des maisons, tout cela ça ne se voit pas. Toutes ces rues dont les eaux stagnent comme des mares, je les compare avec ce qu'ont été celles de Toulouse, il y a 35 ans. Là, dans le faubourg St-Cyprien, on voyait des barques emportées comme des express, tournoyant sur les eaux torrentueuses, chavirant dans des rapides... la Garonne dévalant avec un bruit de Niagara, engloutissant et rejetant tour-à-tour les épaves dans une course houleuse.
Là-bas, dans le Confient, quand le petit torrent, qui passe près de la métairie où je villégiature, se mêle de grossir, de faire « un aygat*1 », on l'entend de loin, et il fait frémir à voir. C'est un spectacle sinistre celui-là : l'eau boueuse, grondant et roulant d'énormes pierres, qui font dans le lit creusé et arraché un bruit mat de bélier ; les arbres déracinés, filant comme des flèches, dans le courant de foudre, les branches tordues, les racines en l'air ; tout cela passe dans une furie de vitesse, de fracas et d'écume.
A Paris, les pertes, les dégâts sont considérables ; le raisonnement vous convainc de leur étendue. Mais cette nappe d'eau énorme descend avec calme. Le courant n'est guère plus rapide que de coutume. La Seine est trouble, mais non houleuse, c'est à peine si les arches des ponts, presque débordées, barrant cette masse liquide gigantesque, la font tourbillonner, bouillonner un peu. Et sur ce fleuve majestueusement enflé, les grandes péniches, amarrées à la queue leu-leu par longues files, somnolent leur vie ordinaire : les mariniers fumant leur pipe, les ménagères vaquant à leurs petites besognes. - Dans les rues transformées en canaux, faisant leur petite Venise, c'est le silence, la quasi solitude ; les façades écourtées se reflétant dans le miroir jaunâtre de l'eau tranquille.- Et sur les bords, ce ne sont que badauds qui se promènent d'un air curieux et intéressé par cette chose « qu'on ne reverra plus dans sa vie ».
Non ! tout cela ne donne pas, quoi qu'il y en ait, « la chair de poule ». Le dramatique ne s'en dégage pas, à première vue. Les malheurs sont latents. Mais, hélas, ils n'en sont pas moindres ! Il y a des milliers de familles sans abri, avant perdu tout leur Saint-Frusquin. Il y a des détresses muettes, inconnues ou seulement soupçonnées.
A côté de cette tristesse, un beau spectacle réconfortant : le peuple de Paris, qui sait toujours se ressaisir dans les circonstances graves, montre un élan de solidarité admirable envers les sinistrés. Ce côté sentimental et compatissant c'est bien le fond du caractère parisien. - J'entends le caractère populaire du véritable enfant de Paris. - Disons aussi, pour être juste, que les dons affluent de tous côtés ; tout le monde verse son obole. - même souvent des sommes considérables, toutes proportions gardées. - « Chacun selon son grade ».
Mais les ruines sont innombrables et je ne crois pas qu'il soit humainement possible d'y remédier dans une proportion consolante.
Je rentre d'une tournée dans la banlieue, vers Villeneuve St-Georges, d'où les eaux se retirent lentement. Là encore, j'éprouve la même impression que dans Paris : les misères sont latentes. La campagne sous les eaux, avec les petites maisons qui baignent leurs rez-de-chaussée, les terrains fraîchement émergés avec leur enduit de vase où traînent des épaves aux attitudes grotesques, rien de tout cela ne donne la notion d'un cataclysme, d'une furie dévastatrice.
Il faut examiner de près certains détails pour lire les détresses qu'ils expriment ; les petites cahutes, bâties par de pauvres gens avec des carreaux de plâtre, qui se sont délayés, et où gisent, dans des tas de débris, des ustensiles divers, de la vaisselle cassée ; ces sortes de campements de miséreux, abandonnés par leurs habitants qu'on devine errants aujourd'hui, ne possédant plus que leurs loques ; les meules de blé (I) que le courant a transportées comme des radeaux, et qui sont venues s'échouer le long des routes en talus, restant là, debout, intactes, à des lieues et des lieues de leur emplacement ; tout cela est triste quand on réfléchit aux conséquences des événements. C'est le désastre survenu presque roidement, sans hâte et sans fracas, avec une sorte de calme implacable.
Non, je n'arrive pas à trouver l'aspect dramatique ni terrifiant à cette campagne où les grands peupliers reflètent leur ramure dans le clapotis de ce grand lac ; à ces champs encore à moitié noyés où gisent des niches à chiens renversées des rondins de bois de chauffage ou quelques rares tables ou chaises boiteuses arrêtées le long des haies. Je pense involontairement à ce minuscule cours d'eau qu'est la Tet, qui, lorsqu'elle est prise de colères, nous fait assister à de si tragiques spectacles. Que serait-ce donc si c'était un fleuve comme la Seine !...
MONTAIGNE neveu
(I) Dans la Brie, la Beauce, etc., le blé après la moisson est mis en gerbes dont on forme d'immenses meules, dans les champs, afin de le soumettre ultérieurement au battage.
(*1) l'aygat, ou aïguat, correspond à un épisode météorologique d'un type proche du “ cévenol ”, c'est à dire avec de très fortes précipitations sur une courte période. Pour exemple, les bains de Vernet ont été détruits par l'aïguat de 1940, qui a vu tomber sur le massif du Canigou environ 1 mètre d'eau en une seule journée, 2 mètres en 5 jours...
mise à jour le