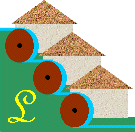

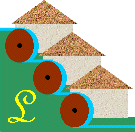
|

|
Un an après avoir quitté Trois-Moulins,en 1911, Henry de Monfreid part pour la Corne de l'Afrique et les bords de la Mer rouge. C'est à ce moment que commencent ce que l'on appelle communément “ ses Aventures ”. Mais ce n'est pas à ce moment là que commence sa notoriété.
C'est en avril 1930, alors qu'Henry à 50 ans, que son nom apparaît pour la première fois au grand public, dans une série d'articles du journal “ Le Matin ”, au sujet des “ Marchés d'esclaves ”. Ces articles écrits par un jeune journaliste, Joseph Kessel, font la Une pendant plusieurs semaines, tenant les lecteurs en haleine. Henry n'a pas encore commencé à écrire.
Le deuxième article est entièrement consacré à Henry sous le titre “ Monfreid l'Aventureux ”. Des extraits figurent déjà sur mon site à la page consacré à un livret de conférence. Le texte original est assez rare à trouver. On peut consulter les articles sur le site Gallica de la B.N.F. (N°2, mardi 27 mai 1930) mais la qualité est assez médiocre. Le texte de cette série d'articles a été regroupé dans un ouvrage de Joseph Kessel, sous le même titre, aux Éditions de France (réédité aux édition 10/18). Je reproduis ici l'intégralité de ce deuxième article, chapitre II de l'ouvrage de 1933.
mise à jour le
Kessel vu par les Éditions de France Monfreid l'Aventureux A Paris, bien peu de gens connaissent le nom d'Henry de Monfreid1. Mais que ce soit à Djibouti, molle et visqueuse, que ce soit dans la brousse éthiopienne, ou parmi les pierres noires hantées des sauvages Danakil, en Érythrée, où les enfants indigènes saluent à la fasciste, dans les ports du Yémen, dans les sables du Hedjaz, chez les plongeurs de perles au creux des îles vierges, bref, depuis l'Egypte jusqu'aux Séchelles, il suffit de prononcer ce nom pour que le Français, l'Anglais, l'Italien, pour que le Somali, l'Abyssin, le Galla, l'Arabe et le Dankali le reconnaissent et que chacun le mêle à quelque récit violent et fantastique.
Monfreid, sans le chercher, a inspiré une légende sur les côtes tragiques de la mer Rouge. L'imagination est sans frein chez les êtres primitifs, elle est chaude chez les blancs que frappe un terrible soleil. Avec les échos suscités par son existence, il serait facile de faire de lui un personnage prodigieux. A quoi bon ! La réalité est assez éloquente.
De famille catalane, fils du comte Daniel de Monfreid, peintre et voyageur, ami de Gauguin, Henry de Monfreid débuta mal. Il fut refusé à Polytechnique et se ruina dans des affaires et des amours médiocres. Sans un sou, le cœur vide, il s'embarqua, il y a vingt ans, pour l'Abyssinie, sur la foi de vagues renseignements, où il était question de commerce de café.
Il avait alors dépassé la trentaine. II considérait que sa vie était achevée. Elle commença.
Il faut à certains hommes, pour développer leurs forces secrètes et fécondes, un climat spécial, aussi bien spirituel que physique. Le destin de Monfreid était de découvrir le sien alors qu'il croyait aller à une retraite végétative.
Ces étendues farouches, peuplées d'hommes rapides et âpres, baignées par une mer brûlante, où ne fréquentaient guère que les sambouks des trafiquants arabes et les zarouks des pirates zaranigs, il sentit soudain qu'il leur appartenait. Sans doute une ascendance maure, une misanthropie naturelle, un sang de contrebandier, un amour passionné de la mer avaient formé chez lui un appétit inconscient, furieux d'aventure et de solitude. Aussi, quand la terre et les flots lui offrirent soudain leurs possibilités infinies et mystérieuses, dans un corps à corps quotidien où l'homme, dépouillé de toutes ses armes artificielles, se trouve réduit à sa propre mesure, Monfreid se révéla lui-même.
Il apprit l'arabe et les dialectes selon lesquels l'ont déformé les tribus de la côte et de l'intérieur. Il méprisa, comme elles, le feu meurtrier du soleil, mangea, s'habilla selon leurs mœurs. Il poussa même cette assimilation jusqu'à se faire circonscrire coraniquement, ce qui, à son âge, montrait quelque patience.
Ainsi trempé, il fit des caravanes dans la région paludéenne et désertique de l'Awash. Il lui arriva d'être poursuivi par des chasseurs d'hommes et il dut, pour leur échapper, se maquiller en noir, en délayant le crottin de sa monture dans sa propre urine, car l'eau lui manquait.
Au cours de ces voyages, il s'aperçut que la marchandise préférée de ces régions était le fusil. Il se fit contrebandier d'armes. Avec le peu d'argent que lui avaient procuré ses caravanes, il acheta un sambouk. C'est une barque non pontée avec une pauvre toile.
Sur cette coquille, Monfreid commença de sillonner la mer Rouge. Il forçait la surveillance anglaise — avant la guerre les autorités françaises ne s'y opposaient point — et débarquait, la nuit, sa cargaison dans quelque crique déserte. Il apprit à connaître tous les îlots, tous les récifs, tous les mouillages. Il entreprit la pêche des perles, s'établit dans une île sauvage au milieu d'un dédale féerique de palétuviers, avec ses plongeurs et ses marins noirs...
Je ne veux pas raconter ici les péripéties de cette existence, car Monfreid en a entrepris lui-même le récit. S'il l'achève, il donnera des mémoires qui sembleront d'un autre siècle, celui des coureurs de mer, des gentilshommes de fortune. On y verra comment il osa rêver de donner, seul, les îles Farsan à la France, comment il lutta contre l'Intelligence Service, comment il passa des armes et d'autres chargements, comment il poursuivit, jusqu'aux Séchelles, ayant monté une bombarde sur son boutre, un bateau où se trouvait la marchandise qui lui avait été dérobée. On lira aussi le naufrage de Ybn-el-Bahar (Le Fils de la Mer), voilier qu'il avait de ses mains construit et qui s'abîma d'un seul coup dans la mer Rouge, et bien d'autres histoires qui serrent le cœur et enfièvrent l'imagination. Et toutes les coutumes, les superstitions millénaires, les rêveries des nakoudas arabes, des matelots somalis, des guerriers danakil, se mêleront merveilleusement aux aventures de ce Français qui voulut vivre une vie de hardiesse, de solitude et de liberté.
Voici onze ans, je revenais de Vladivostok et touchais Djibouti. On me parla de Monfreid.
J'étais très jeune, nourri de romantisme. Je pensai au Manfred de lord Byron. Puis cette image s'effaça...
Un jour de septembre, le lieutenant de vaisseau Lablache, étudiant avec moi les itinéraires possibles de notre voyage aux marchés d'esclaves et pesant toutes les difficultés, me dit :
— Un homme nous débrouillerait tout... Monfreid...
Il me fallut quelques instants pour retrouver les souvenirs confus que ce nom éveillait. Lablache les précisa. Il avait travaillé au port de Djibouti. Ses camarades, sur l'aviso Diana, avaient croisé à la poursuite des sambouks d'esclaves. Lablache me rapporta la légende de Monfreid : contrebandiers... pirates... bateaux fantômes en formaient les éléments essentiels.
— Monfreid... attends...Sans croire à tous les récits, il n'en était pas moins évident que ce Français, ensauvagé et fantastique, eût été pour nous le guide idéal, la clef...
Mais où se trouvait-il ? Sur quel îlot, dans quel désert secret ? Le même regret et la même résignation devant l'impossible firent que Lablache et moi nous changeâmes d'entretien.
Or, une semaine ne s'était pas écoulée que, par un coup de fortune, Lablache, de qui l'ingéniosité semble être l'apanage aussi naturel que le courage et la gaieté, avait trouvé la trace de Monfreid. Et quelle trace : il arrivait à Paris.
Nous ne devions en partir qu'ensemble.
Ainsi qu'il arrive toujours lorsque je dois affronter un personnage pathétique, j'avais très peur en me rendant chez Monfreid. Peur pour l'objet de ma rêverie, pour l'image de lui qu'il allait peut-être lui-même ruiner. Combien lui fus-je reconnaissant d'avoir son visage, ses mouvements, son regard.
A cinquante ans, Monfreid a la mobilité, la souplesse d'un jeune homme. Sa démarche prompte et silencieuse, ses yeux d'un bleu intense sous des sourcils noirs font songer à la fois à la brousse et à la mer. La race catalane se voit dans l'ovale long, osseux, dans le nez aquilin. Mais le hâle indélébile qui, dirait-on, a touché jusque sous la peau, l'apparente aux Arabes. Et puis, et surtout, il est d'ailleurs que les autres hommes. Son costume ne l'habille pas, il le couvre. Dès le premier coup d'œil, on reconnaît que son vrai vêtement c'est le feu du soleil, le vent du large. Sa voix précise, voilée, est faite pour raconter les combats contre les requins, la plongée aux perles, les poissons-fleurs, les mutilations des vaincus.
J'ai été son hôte à Diré-Daoua, dans son usine électrique et à sa minoterie, à Haraoué, dans sa maison, dans son jardin, au milieu de l'eau murmurante, des caféiers, des bananiers, des Gallas qui battent la doura en chantant et des esclaves qui vont chercher du bois. J'ai vécu sur sa terrasse d'Obock où sont accumulés voiles, cordages, petits canons d'un autre âge, toute la mer, toute l'aventure.
Il m'a fait connaître le Gubet Kharab et l'îlot du Diable. J'ai essuyé le vent furieux du Bab-el-Mandeb sur son boutre avec son équipage noir, Et j'ai vu que cet ancien contrebandier, ce pirate, ainsi que l'appellent plaisamment ses amis et perfidement ses adversaires, a servi et sert son pays.
J'ai le devoir de le dire. Car il est trop injuste qu'une si rare destinée et que la légende issue d'elle déformées, salies par les pleutres et les imbéciles, desservent un homme de cette classe.
Il a fait de la contrebande d'armes ? Certes, mais en un temps où cela était permis et même encouragé à Djibouti. Il a importé du haschich en Egypte ? Cela ne regarde que la police du Caire et de Londres. L'Intelligence Service l'a fait porter sur sa liste noire et le traque ? Est-ce une raison pour aider une institution qui ne passe pas pour scrupuleuse et altruiste ?
Par contre, il y a une industrie française en Abyssinie. Elle est à Monfreid. Une oasis française dans le Harrar. Elle est à Monfreid. Il y a dans le massif inconnu du Mablat, chez les guerriers danakil, une maison française là où nul blanc n'a mis le pied. Elle est à Monfreid. Parmi les tribus où 1e gouverneur ne peut rien, le nom du Monfreid est un sauf-conduit.
Ne devrait-on pas utiliser une pareille force, une si longue expérience, une si prodigieuse assimilation ?
Mais, pour comprendre cela, il ne faudrait pas au gouverneur de Djibouti un cœur de chapon. On retrouvera bientôt ce fonctionnaire, car il a voulu qu'une partie de notre poursuite aux esclaves se fît malgré et contre lui. Nous y gagnâmes quelques péripéties et le gouverneur quelque ridicule de plus.
1 Au moment où fut écrit ce récit, Monfreid n'avait rien publié encore et c'est une des fiertés de l'auteur que de l'avoir décidé à relater ses souvenirs.
Joseph Kessel, 1930