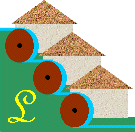
(de juillet à novembre 1918)
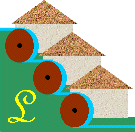
|
Bombon, berceau de la Victoire (de juillet à novembre 1918) |
Pendant la Grande Guerre (1914-18), les châteaux de notre région se transformèrent souvent en hopitaux, pour la convalescence des blessés. Celui de Bombon aura un rôle particuliers : en juillet 1918, le Quartier Général du Général Foch s'y établira.
 |  |
| Carte/Photo Bombon - Le Château, pendant la guerre de 1914-1918. © collection Christiane Wilfart | Carte/Photo Bombon - Le Château, pendant la guerre de 1914-1918. © collection Christiane Wilfart |
C'est là que ce dernier recevra son baton de Maréchal des mains du Président Poincaré.

Carte/Photo - Bombon. - Remise du baton de Maréchal à Foch le 23 août 1918.
© collection Christiane Wilfart
C'est de là que sera lancé l'offensive finale, qui aboutira à l'Armistice du 11 novembre....
Le numéro de la revue " L'ILLUSTRATION " qui suivra l'armistice, consacrera 5 pages à Foch au château de Bombon.
N° 3950-3951 (pages 457 à 461) des 16-23 novembre 1918
 C'est au commencement du mois d'août dernier que M. Charles Duvent, un des artistes qui, au cours de cette guerre, auront le plus enrichi la peinture d'histoire, fut appelé au château où s'était installé, avec son état-major, le maréchal Foch. Déjà la seconde bataille de la Marne était gagnée et l'ennemi était rejeté sur la Vesle. Quand M. Duvent fut admis à peindre le maréchal lui-même dans le salon dont il avait fait son cabinet de travail, ce grand chef, qui, avec tant de simplicité, accordait à un artiste quelques moments d'une de ses précieuses journées, avait conçu et élaboré tout le plan magistral de la manœuvre, d'une souplesse et d'une vigueur sans égales, dont l'exécution allait commencer et qui devait, en trois mois, réduire les armées allemandes à merci. L'aquarelle que nous reproduisons en hors texte, d'une scrupuleuse exactitude dans tous les détails et en même temps d'un si lumineux colons, restera comme un document d'histoire et d'art particulièrement rare et précieux.
C'est au commencement du mois d'août dernier que M. Charles Duvent, un des artistes qui, au cours de cette guerre, auront le plus enrichi la peinture d'histoire, fut appelé au château où s'était installé, avec son état-major, le maréchal Foch. Déjà la seconde bataille de la Marne était gagnée et l'ennemi était rejeté sur la Vesle. Quand M. Duvent fut admis à peindre le maréchal lui-même dans le salon dont il avait fait son cabinet de travail, ce grand chef, qui, avec tant de simplicité, accordait à un artiste quelques moments d'une de ses précieuses journées, avait conçu et élaboré tout le plan magistral de la manœuvre, d'une souplesse et d'une vigueur sans égales, dont l'exécution allait commencer et qui devait, en trois mois, réduire les armées allemandes à merci. L'aquarelle que nous reproduisons en hors texte, d'une scrupuleuse exactitude dans tous les détails et en même temps d'un si lumineux colons, restera comme un document d'histoire et d'art particulièrement rare et précieux.
Deux mois après, au commencement d'octobre, l'envoyé spécial de L'Illustration, Gustave Babin, un des historiographes attitrés de la Grande Guerre, était reçu à son tour au même château, où le maréchal Foch lui accordait une longue audience dont il était autorisé à publier le récit, illustré d'avance par les trois aquarelles de Charles Duvent.
A son article, écrit il y a un mois et demi, notre collaborateur n'a rien changé. Il n'y avait rien à changer. Il ne s'est rien passé depuis, au point de vue militaire, qui n'ait été conforme en tous points aux prévisions du commandant en chef. La victoire est venue inéluctablement, comme il l'attendait : les résultats obtenus en Orient et sur le front italien, les événements intérieurs en Autriche-Hongrie, puis en Allemagne, n'ont fait que brusquer le dénouement.
Aujourd'hui, on le sait, le maréchal Foch ne réside plus au château de B. et il n'y a plus lieu de faire mystère du nom de cette demeure maintenant historique. Le " Berceau de la Victoire ", ce fut le château de Bombon, près de Mormant, en Seine-et-Marne, appartenant au comte de Segonzac.
Aux armées, octobre 1918.
Depuis tant de semaines que le G. Q. G. A. — le Grand Quartier Général des Alliés, celui du maréchal Foch — est établi dans ce vieux château de France, deux fois vénérable, désormais, aux yeux prévenus, combien sont passés devant lui indifférents à sa discrète beauté, sans se demander quels hôtes il abritait, sans soupçonner quelle œuvre illustre, impérissable, s'est élaborée à l'ombre de ses murs ?
On l'aperçoit de la route, pourtant. Il dresse au-delà d'un léger portique de treillage, à l'extrémité d'un parterre à la française bordé de nobles futaies, sa façade de briques fauves encadrées de chaînes de pierres de taille. L'architecture en est sobre, dépourvue de tous vains ornements. Mais il apparaît dès l'abord, au regard exercé, comme découronné, coiffé d'un toit trop bas. De fait, une vue au lavis, en exergue d'un plan ancien du domaine, révèle qu'il fut autrefois abrité d'un comble plus élevé, plus décoratif, agrémenté d'œils-de-bœuf, que quelque catastrophe oubliée aura détruit. C'est le type de ce qu'on est convenu d'appeler le château Louis XIII, — encore qu'il date vraisemblablement de plus loin.
Tel quel, il semble qu'il existe une harmonie préétablie entre son actuel occupant et lui. Il est simple, calme de lignes, grave sans apparat ; il est accueillant, clair. Son plan affecte cette forme que les constructeurs définiraient " en double T ", c'est-à-dire, au milieu, un corps de bâtiment oblong, étroit relativement, avec deux pavillons plus épais aux ailes. Par de hautes baies, la lumière le traverse de part en part : quand, dans le grand salon du rez-de-chaussée, qui est son cabinet de travail, le Maréchal va, de sa table à la carte, de la carte au bureau voisin, un œil aigu pourrait, du chemin, y suivre sa fine et alerte silhouette.
Tout cela, à cette saison, l'avenant château de briques et de pierres, les bois, où les peupliers et les bouleaux, les plus frileux des arbres, se glacent déjà d'un frottis d'or, au milieu des verdures meurtries des chênes, baigne dans une atmosphère douce, blonde, et dégage je ne sais quelle indicible expression de sérénité, de confiance, de paix. C'est le château du calme, du silence, du travail.
 On traverse un coin du village. On arrive à une grille rouillée ; toujours ouverte entre deux piliers moussus, au-dessus desquels se balance, à un fil de fer tendu, une petite lanterne de bois où une scie adroite a découpé ces deux lettres : Q. G. En arrière, un décor à la Théophile Gautier, dont les quelques automobiles de service, rangées discrètement sous les grands arbres, à l'abri d'une voûte d'ombre verte, ne parviennent pas à dissiper l'impression romantique. C'est un massif pavillon de briques et de pierres demeuré coiffé, lui, de son haut comble, couronné d'un campanile et troué d'un vaste porche en arc : une vraie porte de bicoque, seigneuriale, à laquelle il ne manque, pour être un peu rébarbative, que les échauguettes de garde et les mâchicoulis. A gauche, contre le pied-droit de la voûte, un petit fanion : l'enseigne du commandement suprême. En avant, une douve d'eau claire et froide, qui enceint tout le château. Au-delà, une esplanade ensoleillée, une cour en partie pavée, un parterre, avec des labyrinthes de buis. Devant le corps de garde, un, deux hommes, deux soldats ; un autre, à l'arrière-plan, trempe une ligne dans l'onde vive du fossé, taquine je ne sais quelles illusoires fritures, tapies dans des algues qui s'échevellent : voilà toute la garde qui veille à la porte de celui qui laissera sans doute dans l'Histoire le renom du plus grand homme de guerre de son époque.
On traverse un coin du village. On arrive à une grille rouillée ; toujours ouverte entre deux piliers moussus, au-dessus desquels se balance, à un fil de fer tendu, une petite lanterne de bois où une scie adroite a découpé ces deux lettres : Q. G. En arrière, un décor à la Théophile Gautier, dont les quelques automobiles de service, rangées discrètement sous les grands arbres, à l'abri d'une voûte d'ombre verte, ne parviennent pas à dissiper l'impression romantique. C'est un massif pavillon de briques et de pierres demeuré coiffé, lui, de son haut comble, couronné d'un campanile et troué d'un vaste porche en arc : une vraie porte de bicoque, seigneuriale, à laquelle il ne manque, pour être un peu rébarbative, que les échauguettes de garde et les mâchicoulis. A gauche, contre le pied-droit de la voûte, un petit fanion : l'enseigne du commandement suprême. En avant, une douve d'eau claire et froide, qui enceint tout le château. Au-delà, une esplanade ensoleillée, une cour en partie pavée, un parterre, avec des labyrinthes de buis. Devant le corps de garde, un, deux hommes, deux soldats ; un autre, à l'arrière-plan, trempe une ligne dans l'onde vive du fossé, taquine je ne sais quelles illusoires fritures, tapies dans des algues qui s'échevellent : voilà toute la garde qui veille à la porte de celui qui laissera sans doute dans l'Histoire le renom du plus grand homme de guerre de son époque.
*
* *
J'ai traversé, accueilli avec la plus charmante bonne grâce, la pièce où travaillent les deux collaborateurs les plus intimes du Maréchal, le major général et l'aide-major général — un petit salon vert céladon, ancien salon de musique, fleurant bon le vieux, l'élégant passé de France, et meublé, au milieu de jolis bibelots d'autrefois et d'un encombrant piano à queue, relégués dans l'ombre, à l'arrière-plan, d'une mystérieuse carte voilée de serge grise, et de vulgaires tables de sapin sur des tréteaux — enfin d'une causeuse étroite : le siège familier du grand chef, aux heures de travail. Puis je me suis trouvé dans le cabinet du Maréchal. Je ne crois pas, en vérité, que le cœur m'ait jamais battu plus fort.
La salle est haute, immense, sous un plafond à poutrelles de l'ancien temps, un plafond séculaire, qui a pu être le muet témoin de bien des fêtes, voire de drames, mais sous lequel viennent de se dérouler, depuis moins de trois mois, les plus grandes choses qu'il ait jamais vues : c'est réellement ici le berceau de la Victoire, — mieux : le lieu même où elle fut conçue, d'où elle fut conduite par la main souveraine.
Le pavement est de carreaux rouges et noirs, à la vieille mode. Dix fenêtres, cinq sur la cour d'honneur, cinq sur le parterre, éclairent cette salle de proportions harmonieuses, quasi-royales ; elles sont tendues, contre le soleil, d'une soie jaune, qui tamise en un poudroiement d'or la lumière du dehors. Au milieu, une grande table-bureau, du dix-septième siècle, m'a-t-il semblé, mais d'un style anglais, ou hollandais, peut-être, un meuble, enfin, aux garnitures de bronze doré, qui a déconcerté mes faibles connaissances, une jolie chose, au demeurant, sobre, comme tout ici. Et ce bureau, comme nous avions vu celui de l'hôtel de ville de Beauvais, aux jours graves du printemps, quand le général Foch voulut bien nous accueillir, est rangé, ordonné, net. L'objet qui y retient les yeux entre tous est un baromètre enregistreur, dont le Maréchal ne se sépare jamais, qui l'accompagne même dans ses déplacements : l'instrument capital, indispensable, le bon, le sûr conseiller à la veille des grandes opérations ; des caprices du temps dépendent tant de choses ! A droite du bureau, un billard, bien souvent transformé, lui aussi, en table de travail, ample à souhait pour qu'on y puisse à l'aise étaler des cartes. Puis, tout autour, aux murs, entre les hautes baies, quelques vieux cadres distingués, des portraits de famille en atours d'autrefois ; une tapisserie des Flandres, de vieux meubles charmants, laques du Coromandel, acajous, marqueteries, bronzes dorés. Enfin, dans l'angle le plus reculé, contre la dernière fenêtre sur la cour, bien en lumière, surmontée, pour la nuit, de lampes électriques disposées comme une herse, une carte, mobile sur deux cylindres, où se déroule tout le front, de la mer à l'Alsace, où sont indiqués, au jour le jour, les gains de la bataille, depuis l'attaque du 18 juillet : suite de taches lavées de teintes pâles, cernées de traits nets, — ce que, dans les états-majors, on appelle, je crois, en raison de ce bariolage, un " arlequin ". C'est, chaque nuit, la journée finie, la tâche spéciale d'un officier, de tracer le front atteint le soir et d'aquareller le terrain acquis.
*
* *
Avec cette urbanité exquise, cette bienveillance qu'on m'avait bien prévenu que je rencontrerais chez lui dès l'abord, le Maréchal fait quelques pas à ma rencontre, la main tendue. Et, presque sans préambule, il entame la conversation. Ses premiers mots sont pour annoncer une bonne nouvelle :
— Eh bien ! nos affaires vont bien : ils ont évacué Lens. Ils se replient, ils reculent partout.
Je me remémore l'audience de Beauvais, à l'heure où la première ruée allemande était juste endiguée. " Nous allons tâcher de faire mieux ", nous disait ce jour-là le général Foch. Or, il devait connaître, depuis, des jours plus rudes encore que ceux qu'il venait de vivre, l'attaque de la fin de mai, l'inquiétante avance de l'ennemi vers Paris. Pas un moment sa tranquille confiance ne l'a abandonné, n'a même faibli ; pas une minute sa foi n'a été entamée. Et tel je le vois, par cette belle matinée d'automne, cette matinée d'un jour victorieux, tel l'ont vu toujours — ils l'attestent — ses collaborateurs les plus intimes, ceux devant lesquels il pense à voix haute. Sa parfaite égalité d'âme dans toutes les circonstances, qui les émerveille comme un prodige, a rejailli sur eux. Et c'est ce qui explique la quiétude, la paix sereine qui règne en cette demeure, une paix de cloître, reposante, délectable, une paix d'une abbaye bénédictine, où l'on travaille sans répit, mais sans fièvre, sans bruit. D'ailleurs, un état-major restreint ne rappelle en rien l'énorme administration que constitue le G. Q. G. des armées du Nord et du Nord-Est, ou seulement un quartier général d'armée. Le Maréchal n'a pas autour de lui trente officiers, et le château, peut-être, à la saison des chasses, était plus animé naguère, alors que l'occupaient ses maîtres.
Le Maréchal s'est assis à son bureau, m'a, d'un geste amène, désigné un siège, et, ses yeux gris dans les miens, un demi-sourire aux lèvres, demande :
— Que désirez-vous savoir de moi ? Questionnez. Je répondrai.
Questionner ! Mais être là, devant cet homme qui porte avec tant d'aisance le poids du destin du monde ; proférer, pour la première fois, ces mots, dont les lèvres comme les oreilles des Français étaient de si longtemps déshabituées : " Monsieur le Maréchal ", on ne saurait se douter à quel point cela, déjà, est intimidant. " Questionner ", par surcroît, justes cieux ! Enfin, il faut bien s'y efforcer. D'ailleurs les bons yeux clairs, le bienveillant sourire enhardissent. Que bien, que mal, j'expose que, sous ce toit, dans ce salon même où nous sommes, le Maréchal Foch a conçu les desseins qui nous ont amenés à l'ère victorieuse où nous voilà entrés ; que, d'ici même, il a poursuivi l'exécution de ses plans ; qu'enfin je serais heureux de connaître de lui, pour le redire à mes lecteurs, comment, de la détresse où nous croyions être, nous avons passé à ces heures radieuses, où toutes les espérances nous sont permises.
Le Maréchal alors s'est levé, m'a entraîné devant l'impressionnante carte qui occupe toute l'encoignure du vaste salon, auprès de la fenêtre. Je suis à son côté, frôlant presque la manche bleue où scintillent les sept étoiles d'argent clair. Devant moi, la poche profonde d'où s'exerçait la menace contre Paris ; à droite, devant lui, la Champagne, et le mince ruban que céda, volontairement, le 15 juillet, l'armée Gouraud : deux étapes de la lutte suprême sont écrites là en quelques traits. La " poche " de Château-Thierry est maintenant comblée, et au-delà ; elle m'apparaît toute lavée de tons plats, jaune, rosé, vert, violet, et, en avant de la ligne occupée en Champagne le 18 juillet par nos troupes, d'autres strates de couleur, cernées de traits vigoureux, affirment notre avance vers la vallée de l'Aisne, les Ardennes, Vouziers, le large !
Devant cette carte, assis dans ce fauteuil bas blotti près de l'embrasure de la haute fenêtre, le Maréchal a rêvé de longues heures, alors qu'il étudiait la victorieuse offensive dont nous recueillons aujourd'hui les fruits. La grosse poche qui avait amené l'ennemi à Château-Thierry, à la lisière des forêts de Compiègne et de Villers-Cotterêts — disons, s'il vous plaît, la poche de Paris — celle-là surtout le devait inquiéter, s'il était homme à s'inquiéter jamais. Quand il en connut bien toute la structure interne, quand il eut discerné, avec sa prodigieuse clairvoyance, le fort et le faible de l'ennemi enfoncé dans ce saillant, alors son parti fut pris. Le 13 juillet, le sort en était jeté. Et le plan alors arrêté allait se dérouler avec une rigueur quasi mathématique.
A cette même place où il a tant médité, le Maréchal parle. La voix est unie, nette, claire ; le ton, d'une bonhomie charmante. De pittoresques images, jaillies à toute minute à travers cette conversation familière, lui donnent un accent étrangement savoureux.
Des traits de fusain indiquent d'accents circonflexes vagues l'avance du matin, en attendant qu'elle soit, le soir, délimitée d'un cerne précis et couverte d'une teinte plate.
— Voilà, dit-il en me désignant cette ligne ébauchée, ils s'en vont. Ils cherchent à déménager le mobilier, mais ils s'y sont pris trop tard.
Puis, rappelant l'attaque du 15 juillet contre l'armée Gouraud : " Nous avons mis la targette ", conclut-il, mais pour ajouter aussitôt : " Ç'a été magnifique ! On tient... L'armée Berthelot a été un peu crevée. Ils passent la Marne. Ça ne nous trouble pas. "
A cette impavidité devant la menace, le danger, vous reconnaissez l'homme qui, le soir du 8 septembre 1914, la journée la plus critique, pour lui, de la première bataille de la Marne, écrivait d'une plume stoïque : " La situation est excellente : j'ordonne à nouveau de reprendre vigoureusement l'offensive. " Du même cœur impassible dont il avait subi l'effroyable tempête de l'équinoxe, au début de cette rude campagne, avec la même constance il subit le cyclone du dernier printemps.
*
* *
Le moment n'est pas encore venu de retracer méthodiquement, par le menu, les phases de cette bataille gigantesque, qui alluma, embrasa soudain le front entier, y traquant de toutes parts l'ennemi stupéfait. " Nous n'avons pas le temps de faire de l'historique, dit le Maréchal lui-même. L'historique au jour le jour, le voilà. " Et il désigne de son index fuselé la carte bariolée, si éloquente en effet et qui, de soir en soir, allait s'embellissant de glorieuses diaprures.
Ce qu'il a la bonté de m'exposer, ce sont les grandes phases de cette action victorieuse ; et c'est ce que je voudrais pouvoir rapporter exactement : mais, hélas ! Quelle difficulté, de traduire cette causerie vivante, pittoresque, séduisante infiniment, et surtout cet accent si simple, si émouvant par cette simplicité même !
La contre-attaque Mangin-Degoutte s'est préparée en quelques jours : " Le 18, dit le Maréchal, nous la lançons. Nous ne sommes pas gros !... Nous nous couvrons sur la ligne de l'Aisne. " Par là l'impeccable tacticien a pris ses sûretés. De même, quand il poussera en avant les Britanniques dans ce qu'il appelle " l'aventure d'Amiens ". Il les fera se couvrir soigneusement de la Sensée, et ainsi ils ne craindront point de s'aventurer. Tout a été mûrement étudié et pesé. Au hasard, au sort, on a laissé le minimum de chances.
Donc, la poche est attaquée : " Le général Fayolle, poursuit le Maréchal, appelle cela une bataille de poches. "
Les généraux Mangin et Dégoutte frappent à l'Ouest ; le général Berthelot, un peu plus tard, à l'Est. Fin juillet, l'ennemi était rejeté sur la Vesle.
Puis c'est, le 8 août, " l'aventure d'Amiens ". Le général Sir Henry Rawlinson attaque à l'Ouest, le général Debeney au Sud. C'est une progression admirable :
— Alors, je lance le général Humbert. Je lui dis : " Allez-y ! " — "
— Mais je n'ai rien ! " — " Allez-y tout de même ! "
— Je me retourne alors vers le Maréchal Haig. Je lui dis : " II est probable que toutes leurs réserves sont accourues sur nous. Attaquez à votre tour dans la région d'Arras. " — " C'est que je n'ai pas grand'chose... " — " Allez-y tout de même. " C'est la marche générale. Tout le monde donne... Bientôt nous leur lançons l'attaque belge, les 28, 29, 30 septembre...
On connaît les résultats splendides de cette offensive de magistrale allure. Nous en avons cueilli, nous continuons à en cueillir les fruits de semaine en semaine, de jour en jour : villes ou fantômes de villes repris, territoires libérés d'une longue et lourde oppression, populations arrachées l'une après l'autre au plus abominable, au plus odieux des esclavages. Cela commence par Saint-Mihiel...
— Ce n'est qu'un point dans le plan d'ensemble. Nous visons à dégager la ligne de Commercy. Mais vous avez vu avec quelle vigueur et quel succès l'opération a été menée par les Américains. C'est là que, pour la première fois, ils ont donné leur mesure ; c'est là que nous avons pu juger ces admirables soldats, vigoureux de corps et d'âme vaillante. D'un élan ils ont réduit la fameuse hernie que pendant si longtemps nous ne savions comment aborder.
Depuis lors, la liste de nos succès s'est allongée à l'infini. C'est Saint-Quentin qui tombe, puis Lens... Les ruines de Reims sont mises à l'abri de nouveaux outrages. Le Maréchal pourrait reprendre à son compte le claironnant message de Villars : "... J'attaquerai tout ce qui se trouvera devant moi : je percerai tant que terre me pourra porter et pain me pourra suivre. "
— Vous voyez, poursuit l'admirable chef, c'est comme une série de coups d'épaules ; une armée avance, l'autre suit. On pousse tour à tour...
Et le geste, une épaule lancée en avant, puis l'autre, les poings ramassés, précise, accentue le pittoresque de l'image, mime, pour ainsi dire, la manœuvre très sensible, d'ailleurs, saisissante sur cette carte avec son bariolage cloisonné, pareil à un émail, ses zones teintées et datées. De temps à autre, le Maréchal, d'un imperceptible et bref sifflotement, clair comme un hallali, poursuit ses alertes explications,
II m'a conduit un moment devant le billard, afin d'y " kutscher ", ainsi qu'il dit, reprenant une vieille expression d'école, d'y mesurer, sur une carte manuscrite, lavée de teintes plates qui y expriment les altitudes, instrument de travail à son usage, et qu'il affectionne, la longueur du front. " Car enfin, dit-il plaisamment, depuis le temps que je dis 400 kilomètres, je n'en sais rien, au fond. " Puis nous sommes revenus vers l'imposant bureau. D'une main délicate, le Maréchal, grand fumeur, a bourré une petite pipe de bruyère, au foyer doucement évasé en calice : " Vous permettez que je me livre à mon vice ! " Et une bonne odeur monte, avec les volutes de fumée bleuâtre, vers le haut plafond à poutrelles, le parfum, m'a-t-il semblé, d'une suave " mixture " anglaise. Mais j'avais l'esprit occupé, dans ce moment, de tant de choses !...
—Pour parer à ce coup, reprend le Maréchal, ils auraient dû filer du câble, aller se reconstituer quelque part. Mais nous ne les lâchons pas. Ils se battent, je le répète, pour sauver le mobilier. Je ne sais où ils pourront aller se reformer. Attaqués depuis le 18 juillet, ils reculent partout, de la mer du Nord à la Woëvre. C'est un premier résultat désastreux dans l'espace. Les conséquences que nous espérons dans l'avenir doivent être de plus en plus graves, à mesure que le temps passe. Nous pouvons nourrir notre bataille. Nous les pousserons tant que le temps propice nous le permettra. Nous allons, j'espère, les mener tambour battant. Nous tapons à droite, nous tapons à gauche, — et le Maréchal s'anime un peu, et sa voix imperceptiblement s'élève, pour reprendre bientôt son ton posé, en même temps que la figure son calme.
— Ils avaient monté, poursuit-il, un chantier pour marcher sur Paris. Le 18 juillet nous leur avons cassé leur programme, et nous prenons l'un après l'autre les ateliers du grand chantier. Ces jours-ci, à l'Ouest de Reims, nous leur avons enlevé un matériel énorme...
" Ils reculent tout le temps. Et tout cela travaille dans la désorganisation, dans le désordre. Il leur faudrait rompre le contact ; ils ne le peuvent pas, talonnés sans répit. Ils n'ont plus de réserves. On ne leur laisse pas le temps de se reconstituer à l'arrière. "
Quand s'engagea la grande bataille, le 18 juillet, le commandement suprême des Armées alliées n'avait comme ambitions que de dégager le bassin minier du Nord et les deux grandes voies ferrées d'Amiens et de Chalons, dont la privation nous gênait considérablement.
— Ces ambitions ont été dépassées, déclare le Maréchal. Alors nous poussons, nous poussons. Nous exploitons notre avantage. Il faut que toutes les armées donnent. Quand elles stoppent, je les relance. Avec mon bâton de chef d'orchestre, je donne la cadence. Cet appui mutuel que se prêtent les armées, cette continuité dans la pression, c'est cela, qui empêche l'ennemi de se ressaisir et de se réorganiser.
" La Victoire, dit-il enfin, reprenant ce langage imagé, frappant, qui lui est naturel, la Victoire est un plan incliné. A condition de ne pas arrêter le mouvement, le mobile va augmentant de vitesse. "
*
* *
Quelques jours après cette inoubliable audience arrivaient les propositions de paix des ennemis. J'avais moi-même, au cours de l'entretien, évoqué les jours, lointains, je le pensais, je le souhaitais, dans mon désir d'une victoire plus complète, où, autour du tapis vert classique, les chefs vainqueurs — qui sauront bien, eux, pourquoi ils ont lutté — assistés, puisqu'il le faut, de diplomates, causeront avec les vaincus.
— Oui, avait répondu le Maréchal. Mais il faut les pousser dehors d'abord ; les démolir ensuite.
Or, avant de me rendre à cette audience, j'avais relu le texte d'une certaine conférence faite, en 1900, à l'Ecole de guerre, par le général Foch, alors grand éducateur de l'armée de France. Il y disait :
" La guerre assure la réalisation de la victoire par la poursuite, dans laquelle le vainqueur, exploitant la supériorité morale qu'il a sur le vaincu du fait de la victoire, taille en pièce et annihile les troupes démoralisées et dispersées qui ne peuvent plus être commandées, c'est-à-dire des troupes qui n'existent plus. C'est l'acte central de la guerre... "
Et encore : ...
" L'attaque décisive est l'argument suprême de la bataille moderne, dans la guerre de nations combattant pour leur existence, leur indépendance, ou quelque intérêt moins noble, combattant, en tout cas, avec tous leurs moyens, avec toutes leurs passions... "
" ...L'attaque décisive est nécessaire, parce que, sans elle, on ne peut rien accomplir, et nous ne pouvons compter que sur la seule chance. Quand elle est terminée, le résultat est obtenu, et c'est la fin... "
Et plus loin :
" ... Dans la bataille de manœuvre, la réserve — c'est-à-dire le gourdin préparé — est organisée, maintenue en arrière, soigneusement instruite pour exécuter le seul acte de la bataille dont on attende des résultats : l'attaque décisive. La réserve est ménagée avec la plus extrême parcimonie, afin que le gourdin puisse être assez fort, et le coup aussi violent que possible. "
Le prodigieux théoricien de la victoire a réalisé de point en point cette conception, aboutissant de toute sa carrière, résultat de toutes ses méditations, fruit de toute son expérience.
Sans doute, il a eu plus d'une fois à lutter contre les exécutants, qui demandaient des renforts, qui protestaient qu'ils n'avaient " presque plus rien ". Il les a raisonnes, — il leur a donné des ordres sans réplique.
Plus d'une fois, aussi, au cours de ce duel titanesque, il lui a fallu se raidir contre son penchant de bonté, contre son " humanité " profonde — si j'ose employer un vague barbarisme — et se faire à lui-même figure d'inhumain, d'impitoyable. Mais sa ferme volonté de vaincre l'inspirait, et c'est sa résolution inflexible qui a déterminé la victoire, qui lui a laissé les moyens matériels de la réaliser.
Il a, comme il l'indiquait à ses élèves de l'Ecole de guerre, " ménagé avec la plus extrême parcimonie " ses réserves. Il a pu ainsi constituer sa masse de manœuvre, dont les Allemands ne soupçonnaient pas, dont ils niaient, même, l'existence. Alors, pour reprendre sou image, il a tiré de derrière son dos et brandi " le gourdin ". Il l'a asséné, d'un coup " aussi violent que possible ". Et nous voilà au bout de la lutte la plus formidable, la plus farouche qu'ait connue le pauvre monde désolé.
*
* *
J'ai quitté, très ému, vraiment, le paisible château, et, après un coup d'œil au chêne séculaire, qu'on aperçoit de la table de travail du grand cabinet baigné de lumière dorée, au pied duquel le Maréchal reçut naguère le bâton de velours bleu constellé, j 'ai traversé la grande cour ensoleillée et silencieuse, franchi l'arche d'ombre du vieux porche massif.
Je ne crois pas, dans ma carrière, déjà longue, hélas ! Avoir éprouvé jamais d'impression plus vive, plus profonde. Et pourtant, que de grands, plus ou moins authentiques, les hasards du métier ne m'ont-ils point fait approcher !... Mais cette claire, cette lumineuse intelligence qui sourd de ces bons yeux gris, qui vibre dans chaque parole de cette bouche bienveillante ; mais cette âme ferme, indéfectible, qu'on devine derrière chaque acte, chaque geste, et dont on subit l'ascendant, cette âme toujours sereine, toujours égale devant la mauvaise comme devant la bonne fortune, qui a dominé, régi quelques-uns des événements les plus formidables de l'histoire ; et jusqu'à cette providentielle vigueur qui permet au Maréchal, en sa verte maturité, de supporter toutes les fatigues d'un écrasant labeur, les nuits d'étude sous la lampe comme les harassantes randonnées en voiture, d'un bout à l'autre du front, tout cela, en vérité, donne la nette sensation qu'on est en présence de " l'homme prédestiné ", comme parle le poète. A un tel contact, on se sent amélioré, et, j'oserai dire, un peu grandi.
*
* *
A cette trop imparfaite esquisse, je voudrais, pour en terminer, ajouter un trait encore, qui parfait la beauté de cette grande figure.
A quelques centaines de mètres du château, tout au haut de la route montueuse qui traverse le petit village, s'érige l'église paroissiale. Elle est humble, encore que les libéralités, j'imagine, des anciens châtelains, l'aient enrichie de quelques toiles non dénuées d'intérêt, et notamment d'une Résurrection assez bonne, m'a-t-il semblé, qui domine l'autel, encadrée de colonnes corinthiennes dorées ; mais un curieux portique de tuiles, que soutiennent trois colonnettes de granit, ajoute à sa rustique architecture un vague pittoresque. Chaque dimanche, à moins que les devoirs de sa charge ne l'aient conduit en Flandre, en Champagne, en Alsace, au son de la cloche qui appelle les fidèles à la messe de 8 heures, le Maréchal en prend le chemin, en automobile si la besogne ce jour-là presse ; par les beaux jours, s'il a quelque loisir, souvent à pied, salué au passage par les bonnes gens, par les petits enfants du village, respectueusement familiers avec lui, et lui bienveillant pour eux comme pour tous, à l'exemple du Bon Pasteur. Et les humbles ouailles de cette campagne perdue le voient s'asseoir au milieu d'elles, priant avec ferveur, suivant attentivement, dans son livre, les prières de la messe, que dit le curé du village, que sert un soldat bleu horizon ; et, aux tintements de la sonnette liturgique annonçant l'imploration au Dieu des Armées : " Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ", le grand soldat s'agenouille, humblement
Gustave Babin.
mise à jour le